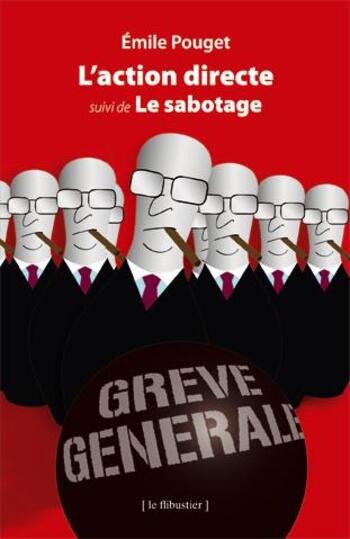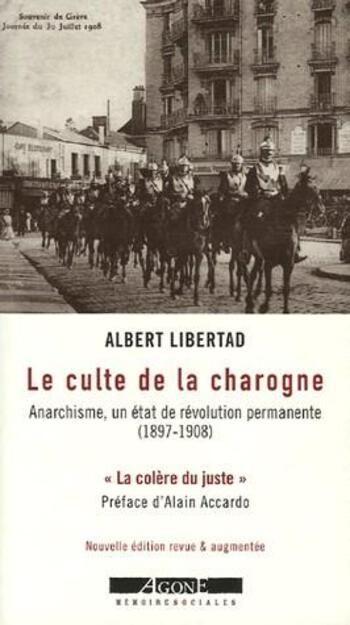Les leçons que la gauche européenne de classe moyenne se complaît à donner aux peuples latino-américains et à leurs dirigeants en pleine transformation de leurs pays ne sont pas le fruit du hasard.
Internet, diversité, écologisme, féminisme, etc... Dans "la naissance du bobo rousseauiste", Jean-Pierre le Goff montre que les thèmes dominants en Occident proviennent en grande partie du fait que les classes moyennes y dominent alors que les secteurs populaires ascendants en Amérique Latine ont d’autres priorités (refonder des constitutions pour créer des États participatifs, réaffirmer et renforcer les droits humains par les droits sociaux, récupérer leurs ressources naturelles au service du développement, démocratiser les ondes, nouer des alliances Sud-Sud, etc..).
C’est là où entre en jeu l’inconscient colonial : l’européen(ne) qui se dit de gauche (ou de droite) se croit encore au centre du monde, et maintient que les priorités des latino-américains doivent être les mêmes que les priorités des occidentaux, d’ailleurs tellement plus subtiles et plus intéressantes. Et il ou elle a le devoir de conseiller, de critiquer le latino-américain puisque c’est pour son bien. Ne lui permettra-t-on pas ainsi d’éviter les erreurs commises dans le passé par la gauche européenne ?
Ainsi, le fait que ces transformations sociales, économiques avancent en Amérique Latine parce que des peuples de plus en plus conscients élisent des leaders qui savent encore leur parler (Bolivie, Venezuela..) est-il montré du doigt en Europe comme germe de populisme, culte de la personnalité, dérive autocratique, etc... La classe moyenne par nature n’a pas besoin d’État, ni de peuple, encore moins de grands hommes. Elle aime que le monde soit à son image.
A l’heure où l’Amérique Latine est devenue en Occident une projection de thèmes d’ONGs, à l’heure où les balises "bobo" ferment le champ de la longue-vue qu’on se prête avec égoïsme, où chaque groupuscule extrait sa plus-value idéologique comme on extrayait hier l’or et l’argent, on est frappé de voir comment, quelques années auparavant, Julio Cortazar avait anticipé et dépassé cette dérive des continents.
Né en Belgique de pères argentins (1914) il aurait pu devenir le parfait européen d’Amérique du Sud comme tant de ses compatriotes de Buenos Aires qui jugent toujours du bout des lèvres les habitants hirsutes de la Calibanie. Fasciné par les passages, les galeries, les associations, la continuité des parcs et la subjectivité du temps, l’écrivain avait réussi pourtant à se mettre à leur place : Cortázar le guatémaltèque, le cubain, le salvadorien, le nicaraguayen.
C’est ainsi qu’un jour la Seine post-moderne déboucha dans les Caraïbes. Cortázar cessa d’être un intellectuel de gauche européen (il n’est pas obligatoire de vivre à Paris pour l’être, on peut aussi vivre en Amérique du Sud et conserver la douce arrogance du parfait "intellectuel-critique-de-gauche-européen") pour se transformer en un intellectuel capable de penser, de critiquer et de sentir depuis nos peuples et depuis nos révolutions.
Policritique á l’heure des chacals, Julio Cortázar
A quoi cela sert-il d’écrire une si bonne prose
A quoi cela sert-il d’exposer raisons et arguments,
Si les chacals veillent, si le troupeau se jette sur le verbe
Le mutile, le détourne de son sens, laisse le reste de côté,
Raisonne en noir et blanc,
si le signe plus se change en signe moins,
Les chacals sont savants dans leurs télex,
Ils sont les ciseaux de l’infamie et du malentendu,
Troupeau universel, blanc, noir, albinos,
Laquais lorsqu’ils ne signent pas et encore plus chacals lorsqu’ils signent,
A quoi sert-il d’écrire en mesurant chaque phrase,
A quoi cela sert-il de peser chaque acte, chaque geste qui donnent du sens
Si par ailleurs les journaux, les conseillers, les agences,
Les polices masquées,
Les agents du gorille, les avocats des trusts
Se chargent de la version la plus adéquate pour la consommation
des innocents ou des crapules,
ils fabriquent le mensonge qui se répand, le doute qui
s’installe,
et tant de braves gens de tant de peuples et de tant de champs de tant
de notre terre
qui ouvre leur journal et cherche la vérité et y rencontrent
le mensonge déguisé, le prédigéré, avalant
la hargne préfabriquée, la merde dans chaque colonnes, il y en a
qui y croient
et ceux qui oublient le reste, tant d’années d’amour et de lutte, parce c’est
comme ça, compagnon, les chacals le savent : la mémoire est
faillible
et comme dans leurs engagements, leurs testaments, les nouvelles du
journal
d’aujourd’hui invalident
tout ce qui précède, enfouissent le passé dans la poubelle d’un présent
trafiqué et mensonger.
Alors non, il vaut mieux être ce que l’on est,
Dire ce qui brûle la langue et tord l’estomac, toujours parler
A qui comprend
Ce langage qui vient des profondeurs
Comme des profondeurs émerge la semence, le lait, les épis.
Et celui qui attend autre chose, la défense ou l’explication fine,
La récidive ou la fuite, jamais plus facile que d’acheter le quotidien
Made in USA
Et lire les commentaires, les versions de Reuter ou
De UPI
Où les chacals pédants donneront la version satisfaisante,
Où des éditorialistes mexicains ou brésiliens ou argentins,
Traduiront pour lui, avec tant de générosité,
Les instructions du chacal basé à Washington,
Ils le feront dans un castillan correct assaisonné à la sauce
Nationale
Avec la merde locale, facile à avaler.
Je ne m’excuse de rien, et surtout
Pas de ce langage,
C’est l’heure du chacal, des chacals et de leurs domestiques :
Je m’adresse à tous et à ceux qui les ont mis au monde,
Et je dis ce que je vis, ce que je sens, ce dont je souffre et ce que
J’espère.
Chaque jour, sur ma table , les coupures de presse : Paris
Londres
NewYork, Buenos aires, Mexico, Rio. Chaque jour
(en peu de temps, à peine deux semaines) la machine remontée,
l’opération réalisée, les libéraux enchantés,
les révolutionnaires confondus,
la violation de l’imprimé, les commentaires affligés,
alliance des chacals et des puristes, le troupeau heureux, tout va bien.
Cela me coûte d’employer la première personne du singulier, et me coûte
plus encore
De dire : C’est comme ça, où c’est un mensonge.
Tout écrivain, Narcisse,
se Masturbe
Défendant son nom, l’Occident
Lui garantit un orgueil solitaire.
Qui suis-je ?
Face aux peuples qui luttent pour le sel et la vie,
De quel droit puis-je emplir tant de pages
D’opinions personnelles ?
Si je parle de moi, c’est peut-être, camarade,
Là où ces lignes te rencontrent,
Tu m’aideras, je t’aiderai à tuer les chacals,
Nous verrons plus net l’horizon, plus verte la mer,
L’homme plus assuré.
Je le dis à tous mes frères, mais je regarde vers Cuba,
Je ne connais pas de meilleure manière d’embrasser toute l’Amérique
Latine.
Je comprends Cuba comme seul se comprend l’être aimé,
les gestes, les distances et tant de différences,
les colères, les cris et par-dessus le soleil et la liberté.
Et tout commence par l’opposé, par un poète incarcéré,
Par le besoin de comprendre pourquoi, d’interroger et
D’attendre,
Que savons nous ici de ce qui se passe, tant que nous sommes Cuba,
Tant que nous résistons chaque jour aux vomissures
Des bonnes consciences,
Des désenchantés, de ceux qui viennent transformer ce modèle
Qu’ils imaginaient à leur façon et , chez eux, dormir
Tranquilles
Sans rien faire, sans regarder de près, leur lune de miel bon marché avec
son île Paradis
Qui est assez lointaine pour être un vrai paradis
Et que de coups portés en son joli petit ciel leur tombe sur la
Tête.
Tu as raison Fidel : c’est seulement dans la lutte qu’existe le droit au
mécontentement,
C’est seulement de cela que peut jaillir la critique, la recherche de
meilleures solutions,
Oui mais de « dedans » est tant de « dehors » à la fois,
Et si aujourd’hui je m’écarte pour toujours du libéral à la violette, de ceux
qui signent les textes vertueux
pourquoi-Cu-ba-n’est-pas-com-me-l’exi-gent-leurs-sché-mas-bu-reau-cra-ti-ques,
Je ne me crois pas une exception, je suis comme eux, ce que j’ai fait pour
Cuba va plus loin que l’amour,
Que j’ai douté de Cuba va plus loin qu’un désir, une espérance.
Mais je m’écarte maintenant de son monde idéal, de ses schémas,
Précisément maintenant quand
Si je me presente à la porte de celui que j’aime, il m’interdit de le
Défendre,
C’est maintenant que j’exerce mon droit de choisir, d’être une fois de plus
et
Plus que jamais
Avec ta Révolution, ma Cuba, a ma façon.
Et ma manière maladroite,
D’une tape de la main,
C’est dire et répéter ce qui me plait et ce qui ne me plait pas,
Acceptant le reproche de parler d’aussi loin
Et à la fois en insistant (combien de fois l’ai-je fait pour le Vent)
Je suis ce que je suis, et je ne suis rien, et ce rien est ma terre
Américaine,
Et comme il peut et où ce signe désigne la terre et ses
Hommes
J’écris chaque lettre de mes livres et je vis chaque jour de ma vie.
Commentaire des chacals (Via Mexico, reproduit avec allégresse à Rio de Janeiro et Buenos Aires) « Le désormais français Julio Cortazar…. Etc. » A nouveau ce patriotisme cocardier, facile et soumis, a nouveau la morgue de ceux qui n’ont que ressentiments, tant qui restent dans leurs puits sans rien faire, sans être entendus sinon chez eux à l’heure de bifteck ;comme si quelque chose me privait d’être latino-américain, comme si un changement sur un passeport ( Et même si cela est, nous n’allons nous mettre à expliquer, le chacal s’en fout et c’est fini) mon cœur changera, mon comportement changera, mon chemin changera. Trop de dégoût pour continuer comme cela ; ma patrie est autre chose, malheureuse nationaliste, je me mouche dans ton drapeau de pacotille, là où tu es. La Révolution cubaine est autre chose, a son achèvement, très lointain, chaque fois infiniment lointain, il y a un magnifique flamboiement de drapeaux, une flambée de chiffons souillés par les mensonges et le sang de l’histoire des chacals , leurs rancœurs, leurs médiocrités, leurs bureaucrates, leurs gorilles et leurs laquais.
C’est comme ça, camarades, si vous m’entendez de La Havane, de
quelque endroit
Il y a des choses que je n’avale pas,
Il y a des choses que je ne peux avaler dans la marche vers la lumière,
personne n’atteint la lumière si il masque les phantasmes pourris du passé,
si les préjudices, les tabous des hommes et des femmes
suivent dans leurs valises,
et si un vocabulaire de casuistes quand ce n’est pas d’énergumènes
arme la bureaucratie du verbe et des cerveaux conditionne les
peuples
que Marx et Lénine ont rêvé libres à l’intérieur comme à l’extérieur
charnellement , en conscience et en amour,
en joie et en travail.
Pour cela , camarades, je sais que je peux dire,
Ce que je crois et ne crois pas, ce que j’accepte et n’accepte pas,
C’est ma policritique, mon outil de lumière,
Et en Cuba je sais de ce combat contre tant d’ennemis,
Je sais de cette île faite d’hommes déterminés qui n’oublient jamais le rire
et
La tendresse
Et qui les défendent amoureusement,
Qui chantent et qui boivent entre des moments de lutte, qui montent la
Garde en fumant,
Ce sont eux que cherchait Marti, ils ont signé du sang de
Tant de morts
A l’heure de tomber face aux chacals de l’intérieur comme des chacals de l’extérieur.
Je ne serai pas celui qui proclame le courage de Cuba et
Son combat ;
Il y a toujours quelque hyène manipulée, poète ou critique,
Prête à chanter les louanges de ce qu’il déteste aux fonds de ses tripes,
Prompt à asphyxier la voix de ceux qui veulent un véritable dialogue,
Le contact
Par le haut et par le bas : contact avec cet homme qui commande
Dans le danger parce que le peuple
Compte sur lui et sais
Qu’il est là parce que c’est juste, parce qu’en lui se définit
La raison de la lutte, du chemin difficile,
Parce qu’il a risqué sa vie avec Camilo et le Ché et tant qui nourrissent de
leurs ossements et de leurs mémoires la terre du palmier ;
Et aussi le contact avec l’autre, le gentil camarade qui a besoin de la parole et d’orientation
Pour mieux faire tourner la machine, mieux couper la canne à sucre.
Que personne n’attende de moi un éloge facile,
Mais aujourd’hui est plus que jamais le temps de la décision et de la clarification :
Dialogue demandé, rencontre dans la bourrasque, critique politique quotidienne,
Je n’accepte pas la répétition d’humiliations maladroites,
Je n’accepte pas les rires des hypocrites convaincus que tout avance
Bien a partir d’un seul exemple,
Je n’accepte pas l’intimidation, ni la vengeance. Et c’est pour cela que
J’accepte
La véritable critique, celle qui vient de celui qui endure le Joug,
De ceux qui luttent pour une cause juste, ici ou là,
en haut ou en bas
et je reconnais la maladresse de prétendre le savoir totalement depuis un
texte exact
et je cherche humblement la vérité dans les faits d’hier et de demain,
et je cherche ton visage, Cuba chérie, et je suis celui qui est venu vers toi
comme on va boire l’eau , avec la soif de la grappe.
Révolution faite d’hommes,
Tu étais pleine d’erreurs et de déviances, pleine de larmes et
D’absences,
Mais à moi, a ceux de tous les horizons qui sommes des morceaux
D’Amérique Latine,
Tu nous comprendras à la fin du jour,
Nous nous reverrons, ensemble, merde,
Contre les hyènes, les porcs et les chacals de tous les méridiens,
Contre les tièdes, les lâches, les scribes et les laquais
A Paris, à La Havane ou à Buenos Aires,
Contre le pire qui sommeille dans le meilleur, contre le danger
De se laisser arrêter en pleine route, de ne pas couper les nœuds
D’un coup de couteau net,
Ainsi je sais qu’un jour nous nous reverrons,
Bonjour, Fidel, bonjour, Haydée, bonjour ma maison,
Mon petit caïman blessé et plus vif que jamais,
Je suis cette parole main à main comme d’autres sont tes yeux ou tes
Muscles,
Tous ensembles nous irons couper la canne,
récolter un temps sans empires et sans esclaves.
Parlons, quoi de plus humain que de se parler : au commencement
fut le dialogue.
Laisse-moi te défendre
lorsque apparaît à nouveau le chacal, laisse-moi être là. Et si tu ne
veux pas,
écoute, compagnon, oublions ces petits problèmes.
Rejoignons nous,
je suis ici, je t’attends, bois, fume avec moi,
la journée est longue, la fumée chasse les moustiques.
Tu sais
je n’ai jamais été aussi proche
que maintenant, de loin, contre vents et marées.
Le jour naît.
Traduction : Michel Veysset, pour www.larevolucionvive.org.ve